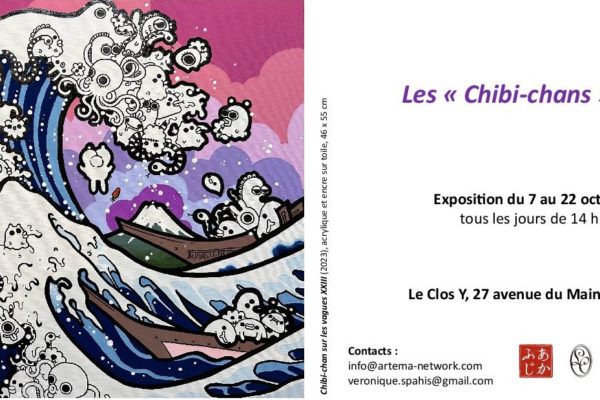Au cours de l’une de ses nombreuses vies, Daniel Mourre travaillait le miroir. Il faudrait écrire des pages et des pages, déployer la plus grande des patiences, revenir en arrière, se poser des questions, se demander par quel côté est née cette prodigieuse réceptivité, pour en résumer la teneur. Sans doute n’a-t-elle d’origine qu’au sein de ces manifestations qu’il faut inscrire au registre des phénomènes merveilleux, ou fantastiques. À ce titre, on aurait tort d’en chercher obstinément une genèse, c’est-à-dire une preuve, afin de valider ce que nous avons ressenti. Une confusion n’est pas forcément une tromperie, non plus que le chaos. L’art de la parole ne passe pas forcément par le langage, encore moins en peinture. Croyons donc à la réalité de cet événement sans le voir tout à fait avec les yeux. Et, pour revenir au miroir, retenons seulement que Daniel Mourre le fabriquait et le montrait. Il creusait la ressemblance, œuvrait pour que les choses et les formes tangibles, les figures concrètes, soient soulignées d’un endroit à l’autre, d’un contour à un autre, par le plus vif éclat. Il procède désormais à la démarche inverse : soutenir que l’image vivante n’est plus, tandis que l’empreinte, elle, demeure.
Au cours de l’une de ses nombreuses vies, Daniel Mourre travaillait le miroir. Il faudrait écrire des pages et des pages, déployer la plus grande des patiences, revenir en arrière, se poser des questions, se demander par quel côté est née cette prodigieuse réceptivité, pour en résumer la teneur. Sans doute n’a-t-elle d’origine qu’au sein de ces manifestations qu’il faut inscrire au registre des phénomènes merveilleux, ou fantastiques. À ce titre, on aurait tort d’en chercher obstinément une genèse, c’est-à-dire une preuve, afin de valider ce que nous avons ressenti. Une confusion n’est pas forcément une tromperie, non plus que le chaos. L’art de la parole ne passe pas forcément par le langage, encore moins en peinture. Croyons donc à la réalité de cet événement sans le voir tout à fait avec les yeux. Et, pour revenir au miroir, retenons seulement que Daniel Mourre le fabriquait et le montrait. Il creusait la ressemblance, œuvrait pour que les choses et les formes tangibles, les figures concrètes, soient soulignées d’un endroit à l’autre, d’un contour à un autre, par le plus vif éclat. Il procède désormais à la démarche inverse : soutenir que l’image vivante n’est plus, tandis que l’empreinte, elle, demeure.
C’est durant l’une de ses expositions que le sol a attiré son regard et lui a dévoilé une force à laquelle il ne s’attendait pas. De là est apparu l’objet qui a fait naître la réflexion qui mène désormais le centre de son existence : la plaque d’égout. C’est le sujet qui l’a appelé et à partir duquel s’inscrit désormais tout son cosmos. Finalement, il y a une répétition des apparitions que l’on trouvait déjà dans son ancien métier. Le miroir en faisait disparaître les variations, tandis qu’à présent l’artiste s’échine à en garder la trace. Il utilise pour cela une matière déjà connue mais qui participe incontestablement à le faire reconnaître : la rouille.
Daniel Mourre déploie des cartographies inédites en les faisant passer de l’horizontalité indifférenciée du sol à la verticalité exaltée des murs. En ce sens, il fait penser aux paléontologues dénicheurs de fossiles, dont les trouvailles, sous terre depuis des décennies, sont ensuite installées dans les vitrines des salles de musée.
À l’origine de la vocation de Daniel Mourre, il y a une impossible concordance avec l’époque : il récupère ce dont elle ne veut pas, s’abrite derrière ce qu’elle cache à nos regards, hisse haut ce qu’elle s’efforce le plus de masquer. Passer par une telle manière, par une telle négation des concepts, ne lui fait pas épouser les penchants les plus actuels de l’art, bien au contraire ; cela aurait même tendance à l’en éloigner et à lui faire approcher ces lieux qui ne cherchent pas à plaire : les grottes, les souterrains, les refuges. Peu importent les emplacements qu’il arpente : de là il tire sa vigueur. Ces boucliers de fonte sont ce qui le protège le mieux des indélicatesses du temps. Concrètement, l’artiste s’en sert de plaques pour les serrer contre des toiles, des feuilles de papier, de la tôle, afin d’en retirer l’empreinte. Il aspire leur ossature et garde leur mémoire vertébrale. Picturalement, il n’est pas le seul à jouer : l’oxydation et le hasard ont aussi leur part de coloration, leur art millénaire de fécondation. Ils s’invitent dans la danse.
Mourre défend deux techniques différentes, qui ont chacune leur poids de fables et d’allégories : l’imprégnation et la propagation. Ce sont des cheminements qui lui permettent d’obtenir des effets graves, dans le cas de la série des imprégnations, ou plus animés, plus dansants, pour la série des propagations, où les plis, replis semblent convier à quelque fête, à quelque célébration joyeuse et enjouée. Ici, moins qu’ailleurs, la présence de la plaque d’égout n’est pas patente. Il faut reconnaître qu’elle n’est pas immédiatement perceptible, parce qu’elle semble céder sa place et s’incliner devant une invasion d’éléments végétaux. De cette façon, l’artiste fait comme une référence à une victoire de la nature après la disparition de l’homme, histoire pour lui de consolider le discours écologique qu’il tient en trame de fond, sans oser l’exprimer tout à fait.
De la même manière, il recueille les empreintes de corps recroquevillés ou allongés, parfois celles de vêtements parfaitement reconnaissables, d’autres fois à moitié effacés. Cela s’inscrit dans la continuité d’un travail bouleversé par des velléités archéologiques. On voit des morceaux de jambes, des mains posées en grande quantité sur des surfaces où elles sont dépourvues de bras. On distingue un penseur à la Rodin, en position fœtale, dans un bloc musculaire sans tête, des débardeurs, des tee-shirts, des combinaisons, des shorts, ou même un drap qui fait songer à quelque linceul mortuaire. Tout est tragique, ici, pris isolément. Il y a bien sûr des notes funèbres dans l’œuvre de Daniel Mourre ; il n’est pas du genre à considérer la peinture comme un délassement. Si l’artiste la regarde gravement, c’est pour mieux faire agir la vérité titanesque dont elle est le réceptacle. On ne peut s’empêcher de penser à quelque catastrophe nucléaire qui aurait tout immobilisé dans son explosion. De même que la bombe d’Hiroshima a fixé la silhouette des hommes et des objets sur les murs des maisons, les empreintes que provoque Daniel Mourre avec ses solutions chimiques amènent le spectateur à se demander si derrière cela quelque désastre est à l’œuvre. On n’imagine pas que cela ait été enfanté sans douleur. Et on ne croit pas que cela puisse être reproduit pour le plaisir.
Ces compositions sont sombres dans leur beauté. Pourtant, çà et là, un soleil apparaît. Il n’est que de voir la série des « Empreintes sur tôle » pour en être immédiatement convaincu : il est difficile d’imaginer un désastre avec des teintes aussi colorées, aussi heureuses de manifester leur présence, leur joie d’être. Heureuse contradiction, sinon délicieux paradoxe : la bouche d’égout devient solaire. Ce n’est plus du ciel que provient la clarté : c’est du sol que jaillit l’éclat. Toute une singularité est à l’œuvre, faite de jaune qui s’allie à du mauve, de turquoise, de rouge qui lutte avec du gris, de l’oranger avec du brun. « Bicéphale » : c’est l’expression qu’utilise cocassement l’artiste pour désigner ces œuvres à double face. Ainsi, la même œuvre peut avoir des humeurs complètement différentes. Cela dépend du côté par lequel on la présente.
On pourrait croire que Daniel Mourre allie l’aube et le crépuscule de notre civilisation, mais il serait plus avisé de dire qu’il pense la civilisation de son aube à son crépuscule, ce qui n’est pas tout à fait la même chose. Dans son travail, le geste ancestral, antique, rejoint la fin des temps, prophétise une société qui aurait basculé dans le chaos. Il ne resterait que des ruines à cause de cette catastrophe industrielle. En cela, le discours de l’artiste lui tient lieu de foi, il s’appuie sur cette vision comme sur une fiction par le biais de laquelle il invente (prédit ?) la chute de l’humanité. Il imagine cette situation de survie en avançant que l’Homme aurait besoin des égouts et des souterrains pour trouver refuge. Pourtant, son art n’est pas un parallèle à ce que l’on connaît de la science-fiction. Ses photogrammes ne se contentent pas de montrer des restes : ils figent des instants d’une terrestre beauté, des couronnements somptueux obtenus par les simples éléments sur lesquels nous marchons.
Désormais, c’est certain : il nous sera impossible de regarder une plaque d’égout comme avant.