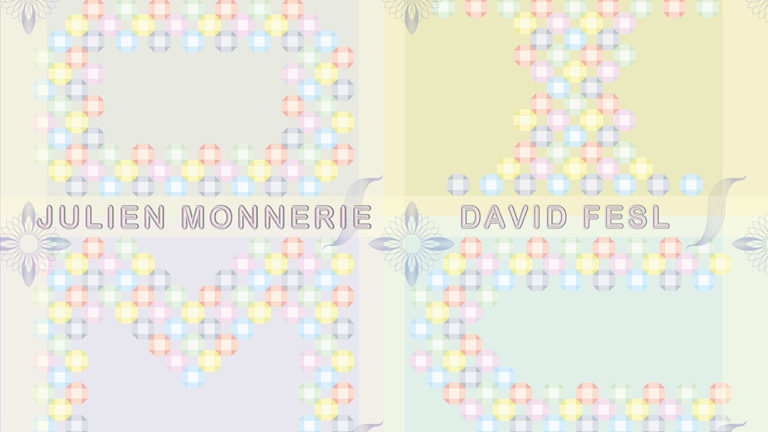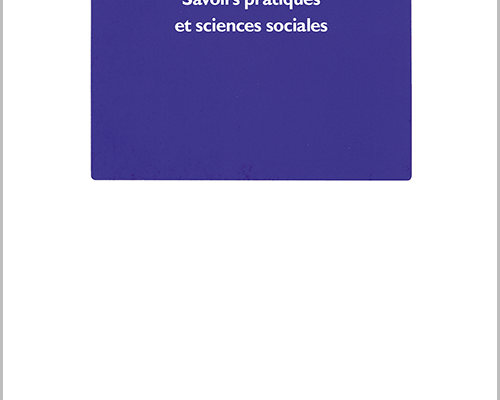There’s a place somewhere
Some place where no one cares
You can be there don’t be scared
The place is everywhere
Homesick, Jesu
Le mal du pays est un mal ancien qui court toujours. Il saisit par surprise en terre inconnue et ne guérit qu’une fois l’exil achevé. Dans cette attente, il éteint les mines et laisse les cœurs gros, et le corps, véhicule à l’arrêt, reste inerte tandis que l’âme s’agite, piégée dans la voie sans issue où elle s’est engagée, croyant emprunter le chemin du retour.
Il n’y a, entre le mal du pays et la nostalgie, cet ennui vague et lourd surgi de nulle part et répandu partout, aucune différence. Elle aussi déplore une perte immense : quelque part, quelqu’un, quelque chose manque et rien n’a plus de goût, et rien n’a plus de sens. C’est un sentiment pâle et grave qui ressemble beaucoup à la langueur monotone de la vie domestique, ce ronron las et sourd que produit un séjour prolongé entre quatre murs.
Car les lieux sûrs blessent aussi. Ces régions d’habitudes qu’il nous tarde de rejoindre aussitôt quittées sont parfois trompeuses. Tout y est à sa place et le chaos, tapi dans un coin, ne fait pas exception. Les maisons sont des êtres bizarres. La plupart du temps, elles survivent à ceux qui les habitent. Certaines sont malsaines. Il y en a même qui tuent.
Les œuvres rassemblées ici entretiennent toutes des liens, étroits ou lâches, avec ces désordres intérieurs. Dans un climat de régression et de révolte mêlées, elles occupent un empire du milieu étrange et familier, ni tout à fait public, ni tout à fait privé, un espace du seuil, voisin de la mue, une position adolescente, à égale distance des ténèbres et du royaume de l’enfance, celui que l’on retrouve avec une joie sévère, celui où tout commence et qui ne finit pas.
Domaines de lutte, demeures en péril, elles sont peuplées d’ “objets transitionnels”*, ceux dont il vaut mieux se munir en cas de carence affective pour affronter la vie de tous les jours, cette “quotidienneté” qui “n’est pas évidence, mais opacité : une forme de cécité, une manière d’anesthésie.”**
La maison est un corps pour Olivia Erlanger (1990, New York) qui la démembre avant d’assigner un créneau horaire à chaque morceau mis sous cloche. Il est exactement 17h13 dans la salle-de-bain, heure d’ordinaire creuse pour les pièces d’eau. Toilettes, baignoire, savon, balance, canard, bouteille d’Evian, plante succulente, produits ménagers… Indices laissés à notre discrétion, vus de face et en plongée entre les paupières rose bonbon d’un judas inversé, cette panoplie miniature renseigne sur le profil d’habitants momentanément absents, autant qu’elle attribue une vie secrète à leur résidence suspecte, par conséquent placée sous surveillance.
Les boxes jumelles de Clémentine Adou (1988, Paris) sont vides elles-aussi. Recouverts par endroits d’un brun souterrain aux effets miroir, ces cartons d’emballage posés au sol quasi tels quels, portent encore les traces de leur vie antérieure. Ils ont contenu quantité de choses et sont passés de mains en mains. Retirés de la circulation et par là-même rendus visibles, ces abris de fortune recyclés en chambres à soi, isoloirs pour exil physique et cérébral, conduisent un projet inachevé. Détente et confidences n’auront pas lieu dans ces refuges impénétrables qui ne laissent, en vérité, aucun répit.
Économie et verticalité caractérisent les pièces radieuses de Julien Monnerie (1987, Rennes). Faites d’éclairages standards mis ensemble et debout, elles parlent du secteur tertiaire au moyen de formes données, aussi génériques que leurs lieux d’usage. Six ampoules et douze tubes fluorescents diffusent une lumière froide qui pourtant réchauffe, comme les flammes d’un ancien foyer. Laissés apparents, câbles et ballasts électroniques alimentent ces totems premier prix dont le corps mince, couvert de points et de bâtons jaunes et blancs, bredouille des caractères illisibles.
Le slogan bégaie chez David Douard (1983, Perpignan). Morceau choisi parmi les logorrhées du mouvement Occupy Wall Street, une injonction à ressentir traverse de haut en bas un simili panneau publicitaire. Les lettres sont à l’envers, comme la maison de poupée, pâté de sable coulé à l’alu, greffée sur un poteau derrière lequel un visage anonyme affiche un rire narquois. Doux et rageux à la fois, l’ensemble a le charme branque du fait maison et l’esprit déviant de la rue. Ailleurs, deux vidéos amateurs trouvées sur YouTube et Google Maps, en génèrent une autre : d’abord, une fille allongée sur un lit s’étourdit entre deux averses de confettis sous les flashs alternés d’un mini stroboscope. Ensuite, dans l’angle d’une chambre nue, une paire de matelas fleuris collés au mur est vue en boucle, de près, de loin et presque plus. À intervalles irréguliers, l’écran vire au noir, comme s’il fermait les yeux sur ces plaisirs solitaires, passe-temps morts.
Paul Bonnet (1990, Paris) sait tromper l’ennui. Entamée en hiver et poursuivie six mois durant, sa toile à la palette incendiaire campe l’outre-monde apparu à sa fenêtre, par couches superposées. Sur un pont, au clair de lune, une bande de spectres marche en file indienne entre deux pans de rideaux dont la présence rassure : cette parade macabre ne serait en fin de compte qu’une vue de l’esprit, un songe obscur inspiré d’un roman d’épouvante***. Toujours est-il que devant ce lacis orange sanguine cerné de vert absinthe saturant l’air du soir de volutes décadentes, nous prend l’envie de rester en dehors, c’est-à-dire au-dedans.
Les vrais-faux autoportraits de Sophie Thun (1985, Francfort) ont été pris la nuit, dans le secret de chambres d’hôtel payées par les artistes qu’elle assiste le jour. Elle y alterne des poses suggestives, fixant d’un regard absent l’appareil qu’elle déclenche à distance. Son double la copie et dans la chambre noire, leurs corps nus mis côte à côte se donnent du plaisir. Deux mains – les siennes encore – tiennent la preuve mensongère de ces ébats en série : elles n’ont pas lâché les négatifs le temps de leur exposition. Jeux de pouvoir, fabrique de l’image… L’envers et l’endroit du décor se confondent, encapsulés dans un même cadre.
Piégés, des pieds de Christ pointent vers le ciel, pareils à deux colonnes grecques. Le gauche se frotte au droit, comme un matin au saut du lit. Ce sont de grands pieds d’homme que Lena Henke (1982, Warburg) a saucissonnés dans un préservatif. Sales, ils macèrent et suffoquent dans cette double peau censée protéger. Leur supplice est d’autant plus pénible à regarder qu’il se produit à grande échelle – 1,80 m, la taille de l’artiste. Piliers insupportables, ils forment un monument vulnérable, un fétiche hideux.
Les grigris de David Fesl (1995, République tchèque), en revanche, sont mignons et tiennent dans la main. Ce sont des idoles païennes, des doudous barbares faits d’objets sans qualité venus de la nature ou de l’industrie, collectés dans un environnement immédiat et assemblés à l’instinct. Corne de cerf, balle de ping-pong, moule à gâteau, cure-dent, écorce d’orange… Il est facile de nommer chacune de ces choses qui ont pourtant quitté leurs fonctions, leurs états d’origine. Sans âge ni genre, jolis et durs, tout en tension, ces ex-voto sont indéfinis. Il est probable qu’ils meurent bientôt et qu’alors, on s’y attache davantage.
Virginie Huet
*D.W. Winnicott, Jeu et réalité, 1971
**Georges Perec, Espèces d’espaces, 1974
***Thomas Ligotti, The Last Feast of Harlequin, 1990