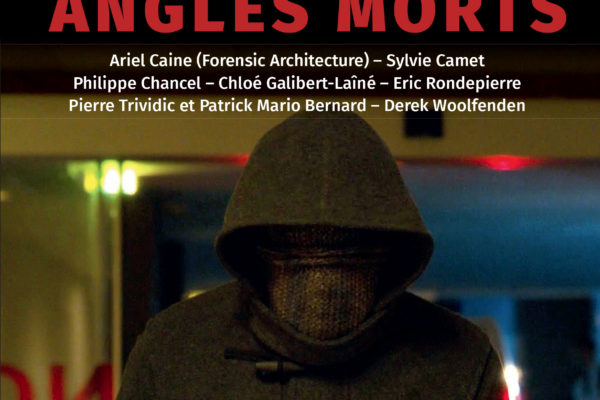Collection Cranford, Mo.Co, Hôtel des Collections, Montpellier
Cette collection anglaise, dont on attendait beaucoup, tient ses promesses, d’autant qu’elle se veut pédagogique en mettant l’acent sur la première décennie du nouveau millénaire et présente les oeuvres chosies par les commissaires selon une perspective historico-chronologique qui ne manque ni de pertinence ni d’intérêt. Le fameux grand public, dont on s’inquiète tant, et qui se plaint de ne pas toujours tout saisir des enjeux de ce qu’on lui donne à percevoir, en aura en tout cas pour ses neurones. Les œuvres diverses présentées lors de cette sélection, que l’on peut qualifier de mise en abyme, (des choix dans d’autres choix) se trouvent en effet confrontées aux événements marquants, innovations technologiques, découvertes scientifiques majeures ou faits culturels des années 2000-2010. Les artistes britanniques (Glenn Brown…) mais surtout les allemands (Kai Althoff, Rosemarie Trockel… ) et les américains du nord (Wade Guyton, Edward Ruscha) ou du centre (Gabriel Orozko) se taillent la part du lion. On déplore la quasi-absence des français (même si Thomas Hirschorn et Thomas Cruzvillegas vivent à Paris) mais on commence à se faire une raison. Toujours est-il que la Collection Cranford, résumée donc à des achats effectués durant les années 2000, comporte un certain nombre de pièces absolument capitales, qu’il s’agisse de la maison en acier et à claire-voie de l’éternelle Louise Bourgeois, des papillons sur toile unie de Damien Hirst (et que dire de ses poissons et arètes mises en cage de verre vers le milieu du parcours ?) ou de la Ronde de nuit, effectuée par un renard dans la National Galery, du belge Francis Alys. On ne compte plus les grands noms : de John Baldessari et sa façon tranchante de manier la scie sur impression numérique à Rebacca Warren et ses bronzes aux attributs féminins exacerbés, en passant par Sigmar Polke (les quatre toiles, suggestives et nocturnes, dans un esprit que l’on pourrait qualifier de romantisme), en passant par Gerhard Richter, présent avec une peinture abstraite, rouge, bien dans sa manière frémissante, au racloir et au scan. La mise en espace est soignée, non pléthorique ce qui permet de respirer entre deux chefs d’œuvre. Des rapprochements judicieux sont effectués (Les photos urbaines archivées par Walid Raad et les sculptures de rapes familières, à taille humaine dans le triptyque de Mona Hatoum, ou encore la scène de viol domestique caricaturée par Sarah Lucas conrontées aux œuvres intimistes, familiales, de Louise Bourgeois/Tracey Emin). Ce qui ne peut que frapper un français, c’est la primauté accordée à la peinture et au dessin, lesquels furent si mal vus durant la même décennie du côté de nos enseignements et élites, ceci expliqnant sans doute cela (l’absence de la France sur le plan international) : D’où ces grands peintres, incontournables, de la scène mondiale (dont nous aurions sans doute les équivalents en cherchant bien dans notre hexagone frileux) : je pense aux grands tableaux, acrylique et huile, d’Albert Oehlen, dont un noir et blanc ; aux références multiples (Mary Schelley, la vierge, un ange..) dans les tableautins de Karen Kilimnick ou à la série dévolue à la chauve-souris, dans les modestes Spartacus Chetwynd. Sans parler de ceux qui renouvellent le traitement du support : Christopher Wool à l’encre de chine ou à l’émail ; les multiples Kelley Walker, en hommage, bricolé et iconique, à la coccinelle (la voiture) ; l’œuvre au noir de Glenn Ligon, à partir d’un texte imprimé de James Baldwin. J’en passe et peut-être des meilleurs (Josh Smith à la recherche de sa signature…). Quant au dessins, bon nombre de planches de Raymond Petitbon, se glissent parmi ses confrères, avec texte en prime ; 12 portraits à la pointe sèche de Thomas Schütte, sans masques, nous rappellent le pas si lointain bon vieux temps, où nous plaignions pour des vétilles, tout en souriant à la vie. La photographie est admirablent représentée par une grande scène, de genre et d’intérieur de Jeff Wall, lumineuse et encaissée, l’un des fleurons de la collection qui s’ouvre par ailleurs sur une installation estivale, et éclatée, de Wolgang Tillmans. Autres belles pièces : la pause clownesque de l’infatigable performeuse Cindy Sherman en petite fille joueuse et, dans, une perpective assez différente, les briques de Damian Ortega se reposant et recomposant autour de diverses maisons suburbaines. Enfin, on affaire aux sculptures et installations : un masque argenté d’Hugo Rondinone, une scatologie stylisée et grotesque de Mike Kelley, les volumes polysémiques en papier mâché de Franz West, une petite merveille de souplesse facétieuse dans les terres cuites peintes de Ken Price, deux coupes débordant de riz et d’esthétique reationnelle selon Rikrit Tiravanija, le roi des orang-utan consuméristes selon Isa Genzken, la stèle colorée, hybride et polémique de Rachel Harrisson… On ne peut tout citer mais il faut souligner l’œuvre lumineuse d’un maître du genre, le danois Olafur Eliasson, qui nous accueille sur le parvis tandis qu’un double film de Phil Collins, performant et musical, nous attend à la sortie. Une leçon de discernement, de saine passion et d’éclectisme bien senti que l’on attend à présent des collectionneurs français. Une plongée dans nos souvenirs communs, et dans ceux particuliers des nouveaux mécènes du milieu de l’art en général. On en redemande. BTN
Jusqu’au 31 janvier, 13, rue République, 0499582800