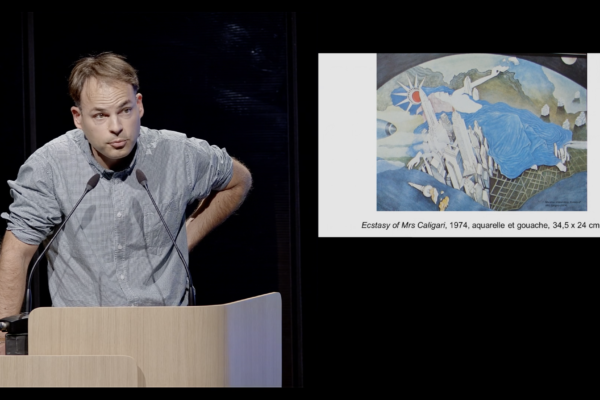Chroniques est une proposition de devenir·art, l’AICA France et revue Laura pour mettre à l’honneur les artistes de la région Centre-Val de Loire et la diversité de leurs approches. Du 10 au 12 juin 2025, Camille Viéville est venue en Région Centre-Val de Loire et a rencontré 3 artistes dans leur atelier. Nous vous invitons à découvrir les textes livrés suite à ces entretiens.
Annie Barrat ou le parti pris du monde
[30/09/25]
« À tout désir d’évasion, opposer la contemplation et ses ressources. »
(Francis Ponge, 1933)
« Images of broken light which dance around me like a million eyes / They call me on and on /
Across the universe. »
(John Lennon, 1968)
Depuis la fin des années 1970, Annie Barrat construit un œuvre aussi sensible que solide. Aux tableaux hantés de figures énigmatiques ou de ruines (Bellaca, 1980 ; Catastrophe 3, 1983) du début des années 1980, que je situe à proximité de ceux de Dorothea Tanning et de Kay Sage, succèdent des œuvres en haute pâte pareilles à des chairs meurtries (série « D’os et de cris », 1988). L’installation en 1991 de l’artiste dans un atelier vaste et clair, toujours le sien aujourd’hui, provoque une révolution dans sa pratique. Ainsi a-t-elle désormais la possibilité de travailler de grands formats, qui impliquent un rapport différent à la toile. Elle offre aussi un rôle nouveau à la couleur, intense, et à la ligne, à l’exemple de la série « Avec la lumière » (1994-1996), marquée par l’influence de l’abstraction américaine des années 1950-1960. En outre, l’artiste privilégie la peinture à la cire, pour sa matité, et développe petit à petit le dessin, puis l’écriture.
Certaines notions – la surface, l’espace, l’échelle, la ligne, le signe, le souffle, la présence notamment – se font récurrentes dans l’œuvre d’Annie Barrat. Celle-ci emprunte son vocabulaire pictural aux formes banales du quotidien (un crochet-ascenseur à cornichon, une étiquette de réduction, une résistance électrique, une bordure-clôture, etc.) qu’elle soumet à une entreprise de clarification, d’ « extraction[1] », écrit-elle, jusqu’à les rendre méconnaissables. Sur la toile, sur le papier ou avec les mots, elle épure le motif, sans aucune sécheresse toutefois, à la recherche de l’équilibre et du déséquilibre, de l’ordre et du dérèglement, de la tension, de l’harmonie.
Annie Barrat laisse le réel pénétrer son œuvre par d’autres biais que celui de la figuration. Elle examine la violence du monde (série « Corps et armes », 2002), la « mémoire de la souffrance[2] ». Elle donne à ses tableaux le nom d’un lieu touché par un événement frappant le jour de leur achèvement, « pour se souvenir[3] », à l’exemple de Izioum (2022), ville ukrainienne prise par Moscou au début de l’invasion russe. Elle consigne avec subtilité les effets de la crise climatique (série « Les lacs disparaissent aussi », 2020) et s’interroge sur les usages policiers de l’intelligence artificielle (série « Passant·e·s », 2020). Le réel est partout et il est politique.
Annie Barrat travaille par séries au sein desquelles elle explore une forme, une idée, un geste jusqu’à parvenir à leur tarissement. Si, dans le tableau ou dans le dessin, elle s’intéresse à la friction de la ligne avec le fond, d’un ton doux avec un autre acidulé, du vide avec le plein, du signe avec le sens, dans la série, elle cartographie d’infinies variations entre les uns et les autres. Parmi ces séries, l’une d’elles, « Les Cibles », m’impressionne par-delà même ses évidentes qualités plastiques, tant elle résume la vision de l’artiste, sa méthode. La série date du début des années 2000, caractérisé par le choc des attentats du 11 septembre et l’impact de la guerre d’Irak. En réaction à cette actualité martiale, Annie Barrat se documente. On connaît les cibles de tir sportif illustrées de cercles bicolores, de croix ou de torses schématiques. On connaît peut-être moins l’équipement du tir de loisir : sur un arceau ou un pied sont fixées des cibles basculantes représentant des silhouettes de sanglier, de pigeon, de lapin ou de renard. Sur un fond monochrome, l’artiste reprend au trait ces formes géométriques, qui appartiennent du reste au langage de l’art abstrait, et ces silhouettes animales, qui composent un imagier presque enfantin de la chasse et qu’elle synthétise encore. La tension naît non seulement du rapport des figures à l’espace bidimensionnel, mais aussi des contrastes chromatiques – contour orange / fond vert, contour rose / fond bleu, contour turquoise / fond jaune, etc. Malgré leur absence, le corps de la proie est évoqué, celui du tireur également. Et l’artiste d’insister : « La peinture, c’est le corps[4]. » La trajectoire fictive de la balle vers la cible fait écho à celle, manifeste, du pinceau sur la toile. La maîtrise du tireur rejoint celle de la peintre. Tous deux partagent les mêmes facultés de concentration et de relâchement. La cible devient un signe équivoque, celui d’une violence et d’une douceur mêlées, celui de la mort et de la vie. Cette série montre, de façon exemplaire, le dépouillement de la peinture d’Annie Barrat, ses ambiguïtés, sans oublier le mélange de focalisation et d’abandon qu’elle exige. Ces dernières années, dans « Le champ des doutes » (2011-2013), ou plus récemment dans « Déserts » (2021) et « Du chaos au cosmos » (2022-2024), l’artiste poursuit ces incessants allers-retours entre les contradictions du réel et l’art, entre le mouvement du monde et la capacité éblouissante de la peinture (ou du dessin) à en restituer la complexité, à force d’exploration et de contemplation, en quelques gestes, dans la solitude de l’atelier.
[1] Annie Barrat, Présentation de mon parcours, 2025, p. 36. C’est aussi le titre d’une de ses expositions personnelles (Galerie de l’Ancien Collège, Châtellerault, 2000).
[2] Ibid., p. 30.
[3] Conversation avec l’autrice, Saint-Avertin, 11 juin 2025.
[4] Conversation avec l’autrice, Saint-Avertin, 11 juin 2025.
Sammy Engramer : à l’art libre
[30/09/25]
« Moi aussi, je me suis demandé si je ne pouvais pas vendre quelque chose et réussir dans la vie. Cela fait un moment déjà que je ne suis bon à rien. » (Marcel Broodthaers, 1964)
Chez Sammy Engramer, l’œuvre comme « acte de création[1] » reflète un désir bouillonnant d’analyse et de compréhension. Il aspire, avec elle, à saisir la complexité des rapports sociaux et politiques, à se connaître lui-même. L’artiste nourrit sa pratique de la lecture attentive de Simone de Beauvoir, Friedrich Nietzsche, Colette Soler, Jean-Loïc Le Quellec ou G.W.F. Hegel, pour n’en citer que quelques-uns, cultivant ainsi un regard critique sur le monde.
Depuis la fin des années 1980, Sammy Engramer peint des tableaux (Cible, 2006), imagine des objets (Crantoulière, 2014) et crée des installations (L’architecte est absent, le maçon a pris la fuite, 1999), diffusés autrefois via un site arborescent (dont je vous recommande la visite[2]) avant qu’Instagram ne prenne le relais. Mais sa production ne se limite pas à cela. Elle est aussi composée de livres d’artiste (Mars, 2005 ; Jean-Antoine Watteau Pique-Nique, 2006 ; etc.), de textes théoriques (publiés dans les revues art présence et Laura notamment), et de vidéos-fleuves, car l’homme est loquace, dans lesquelles il documente avec générosité son approche, par « des spéculations voire, si vous voulez, des élucubrations[3] ». Enfin, il conçoit des expositions thématiques (Supdelux, 2024 ; Talking Sex, 2021 ; etc.) qui lui permettent de structurer son travail, « à la manière d’un album de rock[4] ». Rien d‘étonnant à cela pour cet amateur de punk : le D.I.Y. et son goût des marges contribuent à tenir à une distance saine les principes capitalistes (productivité, profit, marchandisation et consommation, etc.) de la scène artistique.
Sammy Engramer emploie volontiers dans son travail les ingrédients suivants : ironie, pédagogie et design. Le langage, « une conquête[5] », suggère-t-il, et la place qu’il lui donne à travers de fréquents jeux de mots, mots d’esprit ou mots-valises, lisibles en toutes lettres dans ses tableaux et installations, dans le choix des titres ou les textes qu’il rédige, y sont déterminants. Grâce à cet usage du langage, l’artiste signale une idée sous-jacente autant qu’il saborde, avec délice par ailleurs, son autorité, ses normes, ses règles. Cet usage est aussi hérité d’une certaine l’histoire de l’art moderne, de Marcel Duchamp (L.H.O.O.Q., 1919) à l’Internationale Situationniste (le slogan « Ne travaillez jamais » en 1953 par exemple) en passant par René Magritte (La Trahison des images, 1929).
De l’ensemble du travail de Sammy Engramer point une question majeure : celle de la domination (je pourrais faire honneur à la tautologie et aller jusqu’à écrire la question de la domination domine). Dans son texte Le Maître (2022), il remarque : « La figure du maître s’immisce au niveau des sommets de l’État ou de la fonction publique […], des entreprises privées […] ou des fondations, corporations, […], des organisations religieuses et criminelles […], enfin, au sein de chaque famille […]. Les rapports de hiérarchie et de domination vont de soi dans toutes les strates de la vie politique, sociale, économique, familiale. L’ÉTENDUE DES DOMINATIONS est dense et constante dans toutes les sociétés humaines[6]. » Sammy Engramer décline ces différentes typologies de la domination. Il examine la tyrannie politique – Monument pour une dictature (2020), cage en acier haute de 6 mètres –, et le pouvoir patriarcal – Bikini Kill (2013-2019), barrière de police monumentale, tendue d’une bâche portant l’inscription « Fuck Patriarcat » –, les subtilités de la relation de maître à esclave – Retour vers l’hystérie 2 (2021), le mot « érectrice » peint sur un fond bleuté –, ou encore la lutte des classes – L’ascenseur social (2023), escalier aux marches hérissées d’échardes, menant droit dans le mur. Cette recherche est enfin un moyen d’interroger le statut de l’œuvre et celui de l’artiste dans un milieu artistique où la logique d’exploitation prévaut. Déjà, en 1989, étudiant à l’École nationale supérieure d’art de Bourges, il ouvrait avec Etienne Baboulène un appartement-galerie où rien n’était à vendre. Sensible au cynisme antique, Sammy Engramer emprunte, à contre-courant, une voie subversive, parfois solitaire, souvent drôle et toujours libre.
[1] Conversation avec l’autrice, Saint-Pierre-des-Corps, 11 juin 2025.
[2] http://sammy.engramer.free.fr/Page1.html La mise à jour du site s’est arrêtée en 2023.
[3] Sammy Engramer, 17 Aurore borroméenne sous les tropismes, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=omtFH-7Te1M
[4] Conversation avec l’autrice, Saint-Pierre-des-Corps, 11 juin 2025.
[5] Ibid.
[6] Sammy Engramer, Le Maître, [Tours], Laura Delamondade, [2022], n. p., disponible en ligne : https://sammyengramer.labomedia.org/pdf/schuldering-1.pdf
A mind trip, a body journey. Avec Pauline Toyer
[30/09/25]
« This is not a mind trip, this is a body journey [1] », susurre la voix en ouverture de Liquid Air, un des morceaux les plus connus d’Air Liquide, groupe de techno des années 1990. Pauline Toyer a donné ce nom d’Air Liquide (2021) à l’une de ses installations, composée de tissu imprimé, d’emballages de médicaments mis sous vide, de son (créé par Celsian Langlois) et d’un matelas gonflable, juché de cartouches de protoxyde d’azote (N2O). Ce même N2O, aussi appelé gaz hilarant, qui est aujourd’hui massivement employé comme drogue, détourné de son usage médical (anesthésiant) et industriel (propulseur de crème chantilly), en vertu de ses effets euphorisants. Air Liquide raconte un monde malade, étouffé par ses déchets, où chacun cherche, comme il peut, à reprendre son souffle. Elle est non seulement une œuvre importante dans le travail de l’artiste, pour sa richesse plastique et sémantique, mais aussi une œuvre exemplaire quant à son élaboration.
Depuis le début des années 2010, Pauline Toyer développe une pratique pluridisciplinaire (installation, peinture, photographie, dessin, etc.) où la sculpture – c’est-à-dire le rapport à l’espace, au point de vue – prévaut. Par glissements, par ricochets, elle sample les formes, les références, les objets. Ainsi, après Air Liquide, rencontre-t-on dans Falling Asleep (2022) un autre lit de camp, accroché au mur celui-ci, peint d’un motif de circuit imprimé et de plateforme de livraison, semblable à une projection standardisée sur l’écran de nos nuits. Les cartouches de N2O, de différentes tailles, et les plaquettes de médicaments réapparaissent quant à eux, çà et là, s’accumulant comme sur les trottoirs des grandes villes. La sculpture C.R.E.A.M. (2022) rassemble ces bombonnes sur un présentoir aux faux airs seventies, non en plastique orange mais en bois et plâtre blanc. Pauline Toyer a choisi la marque de cartouches de N2O C.R.E.A.M. – acronyme de « Cash Rules Everything Around Me[2] » –, nous rappelant, si cela était nécessaire, que le cynisme capitaliste est sans limites.
Dans le bel atelier de l’artiste à Cormeray, en juin dernier, de nouvelles pièces sont en préparation, dont certaines avec d’autres bombonnes de C.R.E.A.M., celles-ci de taille magnum et ornées d’un cobra : « Mon obsession récente se porte sur le serpent, explique Pauline Toyer, en plus des mythes dont il est le vecteur, ces formes serpentines viendraient d’une certaine façon s’échapper de la grille moderniste[3]. » Ainsi le trouve-t-on déjà dans Bread Dance (2024), une installation pareille à un diorama, conçue pour la Borne du POCTB, module d’exposition itinérant en région Centre-Val de Loire[4]. Elle porte sur la prédation et son organisation, sous l’aspect ludique d’une machine attrape-peluche et celui plus inquiétant d’un terrarium. Au centre, dans une lumière éblouissante, un énorme serpent en plâtre peint guette ses proies, peut-être les spectateurs dont des miroirs renvoient le reflet.
Ces ramifications se connectent elles-mêmes à d’autres motifs, récurrents et connexes. Ainsi, aux côtés de l’objet industriel, parfois monstrueux, et de l’animal, le corps humain est suggéré dans de nombreuses œuvres, à l’exemple du bien-nommé Le grand nez (2024) : un organe en plâtre haut d’un mètre quarante, sorte de chaînon manquant entre le sphinx de Gizeh (2500 avant notre ère) et les Lemurenköpfe (1992) de Franz West. Rosa (2024) est quant à elle composée de deux sculptures qui évoquent tout à la fois des enceintes (si elles n’émettent pas de son, elles diffusent une lumière rouge), des guimauves géantes et une paire de seins ou d’yeux, peut-être, jusqu’à produire un carambolage entre formes industrielles et organiques à la manière d’un David Cronenberg dans les années 1980-1990. Parfois, le corps se métamorphose à la croisée de l’histoire de l’art et de la culture pop. Ainsi, dans Around me (2024), deux mains jointes, traitées en haut-relief se joignent, qui rappellent toute une tradition de la sculpture en terre cuite vernissée. Mais un embout plastique de cartouche C.R.E.A.M. glissé entre les doigts, nous ramène brutalement dans le monde contemporain. Selon l’angle, les vides laissés au centre des poignets et des mains dessinent un masque horrifique, celui du célèbre film de Wes Craven, Scream (1996), dont une rumeur persistante dit qu’il a été inspiré par le non moins célèbre tableau d’Edvard Munch, Le Cri (1893). Comme si les strates hétérogènes d’une culture visuelle commune se trouvaient concentrées en une forme unique. Le travail de Pauline Toyer, traversé d’images et de matières en constante mutation, est affaire d’esprit autant que corps : « This is a mind trip, this is a body journey. »
[1] « Ce n’est pas un trip de l’esprit, c’est un voyage corporel » (je souligne).
[2] « L’argent règne sur tout ce qui m’entoure. »
[3] Pauline Toyer, Portfolio 2014-2024, 2025, n.p.
[4] http://www.poctb.fr/spip.php?article471