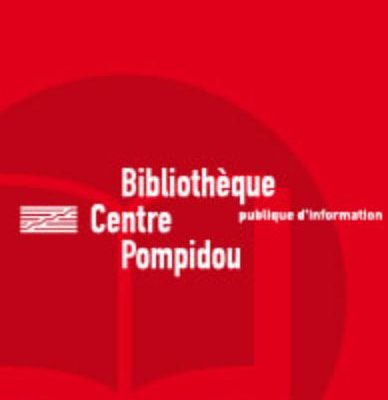Sophie Calle, MRAC de Sérignan (34)
L’ambassadrice la plus célèbre de l’art français dans le monde, en tout cas parmi les vivantes, Sophie Calle, méritait bien une exposition muséale dans notre région : on eût pu penser à Nîmes, au vu de son parcours et de ses ascendants gardois, c’est le Mrac de Sérignan qui l’a (très bien) fait.. L’espace à l’étage est remodelé de sorte que Sophie Calle puisse présenter des séries quelque peu ambitieuses et fournies. Douleur exquise choisit l’axe chronologique pour mettre en scène les clichés renvoyant aux 92 jours de désœuvrement précédant une rupture amoureuse, brutale et inopinée, de celle qui marque à vie. D’un côté, l’avant, les photos et textes, innocents et impatients, d’un voyage au Japon. De l’autre, la terrible douleur de l’après. On retrouve la spécificité de l’art de Sophie Calle qui associe, une image, en l’occurrence celle d’un téléphone dans un hôtel indien, à du texte écrit, à des confidences, à son besoin d’expression. Sophie Calle a combiné son expérience particulière à la souffrance des autres, en bandes verticales régulières. La douleur se fait fédératrice et la vie œuvre d’art, la réalité autofiction, généralisée, avant la lettre. Dès l’entrée, on repère la clé, concrète, de l’intitulé général Etes-vous triste ? (La visite médicale) et le rappel, par titres de Série Noire interposée, des séries résumant la carrière de l’artiste. Celle-ci ne limite pas sa production à la photo assortie du texte. Une petite salle est transformée en chapelle ardente où l’on assiste à l’agonie de la mère, conjuguée à des images de Pôle Nord dont celle-ci rêvait. L’artiste n’a point hésite à faire ensuite le voyage afin d’enterrer, dans la glace arctique, les objets précieux de la défunte, selon ses volontés. Les séries consacrées à Berck et Lourdes, guidés par une cartomancienne, révèlent une artiste qui laisse une grande place à l’improvisation, en tout cas dans ses recherches. Enfin on est impressionnés par les images mouvantes, et pourtant quasi-fixes, d’aveugles d’Istanbul évoquant la dernière perçue avant leur brusque cécité. Au rez-de-chaussée, nous attendent, les portraits maritimes de personnes portant leur premier regard sur la mer, toute proche rappelons-le, dans une immense installation vidéo. On retrouve l’émerveillement qui sied effectivement à une merveille, que nous finissons par oublier de trop la voir.
Le Mrac conserve par ailleurs une riche collection en permanence renouvelée, où l’on retrouve, entre une cabane lumineuse de Buren et une cabine dévolue à Nathalie du Pasquier, des artistes de toutes nationalités (Allons, d’Armleder à Veilhan en passant par Beloufa, Dolla, Kusnir, Mosta-Heirt, Traquandi ou notre alésienne Mimosa Echard…). Dans le cabinet d’arts graphiques, ce sont aussi les aquarelles de trombes, de tornades déferlantes, de jardins ou bassins et d’atelier de Toma Dutter. La plus convaincante occupation à ce jour dans cet espace discret du Musée. De maquettes aussi d’abris en bois, montées sur trépied, dans un esprit d’adaptation aux caprices de la nature. BTN
Jusqu’au 21-09
Lucas Arruda, Ivens Machado, Carré d’art, Nîmes
Carré d’art s’est mis à l’heure brésilienne. 3 artistes défendent les couleurs de leurs pays, une jeune, un confirmé et un pionnier aujourd’hui décédé. Lucas Arruda, c’est la preuve paradoxale que la peinture, plus particulièrement figurative, gagnait du terrain sur le plan international tandis qu’on la boudait en France, du coté des Beaux-arts comme dans les lieux officiels. Son succès est d’autant plus étonnant qu’Arruda pratique le très petit format, un genre aussi traditionnel que le paysage et qu’il ne tient pas un discours tonitruant et devenu coutumier : critique du capitalisme, du colonialisme, de l’ingérence, du patriarcat, de la « norme » sexuelle… Les plus frappants sont ceux marqués par la ligne d’horizon, laquelle entre en tension avec l’espace du musée donnant l’impression que la peinture fait le vide autour d’elle et dépose le paysage, sur la surface du tableau. Le spectateur est invité à s’approcher pour s’imprégner de la douceur des atmosphères, de leur indécision assumée et de l’unité de ton qui harmonise l’ensemble. A ces visions dépouillées, qui tiennent avant tout par l’impression d’équilibre et par la spiritualité qui s’en dégage, s’ajoutent des jungles imaginaires, qui ne cachent pas leur appartenance aux modèles du désert (Deserto-Modelo). La frontière entre les 2 univers est traduite, dans les tableaux, par le passage assez souple de la terre au ciel ou de ce dernier à la mer. Que l’on ne s’y méprenne pas toutefois. La deuxième partie de l’expo pourrait surprendre voire décevoir les nouveaux gagnants de la peinture triomphante. On quitte la délicatesse du geste, la subtilité de la lumière, la finesse veloutée des couleurs, le caractère atmosphérique du paysage. Une série de diapositives révèle une dimension plus expérimentale, la gravure se faisant directement sur le medium. Ensuite, le visiteur est confronté à une salle épurée, présentant des carrés lumineux, immatériels, imposant la présence du vide. L’importance de la lumière se fait éclatante et l’on accède à une dimension autre. Enfin, la vidéo d’un boxeur, dans le coma en fin de combat, nous laisse sur une note ambiguë. On pense à une déposition christique. L’humain y fait l’expérience des limites. Changement d’ambiance pour, Ivens Machado dont le travail se rapprochait de l’Arte povera (sculptures faisant appel au charbon ou au béton), ou de l’art corporel en vogue dans les années 60-70 (photos et vidéos de performances). N’oublions pas les années de dictature et de violence qu’elle a engendrées. Ces réalisations ne manquent pourtant pas d’humour, en particulier cette énorme chaussure de femme à talon avec sa langue pendante, ou cette sorte de chaise trop haute avec dossier de verre et montants de tiges en fer. Au Musée des Beaux-arts, Marina Rheingantz s’inspire de tableaux des Collections afin d’en offrir sa lecture, toute en sensibilité, sur toile abstraite, tantôt chargée de matière colorée, tantôt au contraire plus dépouillée. Le réel semble s’éparpiller sous ses yeux qui n’en retiennent que les sensations colorées. BTN
Jusqu’au 05-10
Hommage à Piet Moget et Carel Visser, Dialogue avec Wieteke Heldens, LAC, Sigean, 11130
On ne souligne pas assez le rôle que le LAC de Sigean aura joué dans l’animation artistique du grand Languedoc bien avant que le Crac, le Mrac, le Miam, a fortiori les Moco, n’aient vu le jour. On le doit à l’énergie et la passion d’un homme, l’artiste et collectionneur Piet Moget, lequel nous a quittés cela fait 10 ans maintenant. Un chiffre rond, ça se fête. Sa fille Layla a pris le relais, qui rend cet été hommage à son père, né et décédé la même année que son compatriote, le sculpteur néerlandais Carel Visser. Peinture et sculpture sont faites pour se compléter et se partager l’espace, il n’en manque pas aux anciens chais du LAC. Il fallait pourtant ne pas figer les deux artistes dans le passé, et prouver qu’ils pouvaient dialoguer non seulement entre eux mais avec les nouvelles générations. C’est ce qui explique la présence de la néerlandaise Wieteke Heldens, laquelle apporte de surcroît sa touche, si l’on peut dire, féminine. Piet Moget, à l’instar de son ainé Mondrian, a peint tout d’abord des paysages avec arbres et sans personnages, ce qui ne l’empêchait pas de pratiquer en même temps le portrait intimiste. Durant l’après-guerre, et sous l’influence de Geer Van Velde, il a petit à petit dépouillé le tableau de ses figures pour se concentrer à la fois sur la ligne d’horizon, sur une palette lumineuse et nacrée ou irisée, et sur le genre de la marine aux limites de plus en plus indécises entre les éléments. C’est un peu ce que l’on retrouvera dans cette expo estivale, en grand et petit format, avec une majorité de tableaux peints à Port la Nouvelle, sur le motif, selon un protocole quotidien parfaitement rodé. Piet, c’était l’obstination à repeindre incessamment le même paysage, une étendue marine sous un ciel plus proche sans doute de sa mer du Nord natale et de La Haye que de notre midi méditerranéen. La ligne d’horizon variait, d’un tableau à l’autre, elle se chargeait même d’irisations subtiles et la lumière présentait de multiples apparences, plus ou moins atmosphériques, justifiant la quête tenace de sa lente saisie, à l’huile. Ainsi traitait-il autant du temps que de l’espace. Il privilégiait le carré, à échelle corporelle, mais recourait aussi au rectangle, vertical ou horizontal. Comme il n’aimait pas peindre en intérieur, l’horizon marin à lui seul résumait le monde extérieur, tous les voyages possibles, réels ou imaginaires. Voire le monde dans sa totalité, concentré sur deux pôles, le marin et le céleste, sachant que le peintre gardait les pieds sur terre. Dans les années 60, il s’est essayé à la représentation d’une sphère, comme amarrée au paysage qui persiste. C’était une manière de suggérer l’envol vers le haut et donc un voyage vertical, lui qui a tellement privilégié l’horizontale. Car le peintre doublait son attachement au réel d’aspirations d’ordre spirituel.
Carel Visser a alterné le minimalisme de plus radical et des réalisations plus allusives de type animalier ou végétal. Il construisait, en fer ou acier, des pièces puissantes fondées sur l’accumulation, l’entremêlement, la juxtaposition. Il se référait à l’architecture intérieure et ses poutres, fenêtres, escaliers. Mais sa créativité débridée le poussa vers des matériaux moins austères et qui se plient, se roulent, penchent, glissent et se suspendent. Il introduisit des objets récupérés (pneus ou vitres par ex) et par là même la surprise et l’humour. Ses réalisations se nomment alors Animal, Sailing car et même Landscape. Il se glisse aussi le long des murs où apparaissent d’étranges créatures, tout en dynamisme et fantasque, en carton découpé frotté au graphite. Visser c’est la surprise garantie, une façon bien à lui de dompter le matériau en le poussant jusqu’aux limites du burlesque, du décalé, de l’hybride même. Au Lac, on pourra voir aussi ses dessins et collages sur papier dont un auquel il associe une grappe de raisins, qui font sens dans cette Aude viticole.
Le travail pictural de Wieteke Heldens se veut avant tout léger, jouant sur la dissolution et la distribution des formes et couleurs sur la surface. Elle semble collecter des gestes, leur adjoint des nombres, se rapproche d’une écriture abstraite. Elle s’est constituée une mythologie propre, issue de ses voyages (New York) ou de ses origines (The Légend of Holland). Elle est la véritable révélation de cette proposition tripartite, placée sous le signe du plat pays. Et du dialogue intergénérationnel. « Intergenres » aussi. BTN
Du 06-07 au 26-09